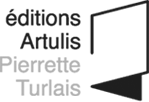Grimoires illuminés de Pierre Richard
Christophe Stolowicki, revue Sitaudis en ligne, février 2020
Avec l’affreux rire de l’idiot, soulever, le poing desséché, le couvercle du cercueil, peindre inlassablement le même tableau, en ses variantes finies infinies, un monument conjuratoire hérissé de herses et de saints démoniaques, d’arriération en campagne, de tout l’ostinato de l’anaphore, à l’opposé d’un rapin à périodes ; des incunables d’art brut, en fond la couleur même du Temps, de terres basses, de rayons ras, ce gris-beige lépreux, précieux, fondamental, qu’ont porté au monde Pieter Brueghel le Jeune, Jérôme Bosch, Maurice Pialat sous le soleil de Satan, et sur lesquels les rehauts de rose, de bleu, de vert, sont comme passés au mouroir. Creusé profond dans les siècles le sillon, le boustrophédon. Le foisonnement rappelant Chagall. D’art convulsant, épurant l’abstrait comme le suprématisme. Précurseur du lettrisme, du dadaïsme, d’isthme en isthme élargissant son propos. Provoquant un effet de hantise à l’égal des plus grands.
De Pierre Richard (1802 – 1879), issu d’une famille de laboureurs lorrains devenus rentiers par le revenu de leurs terres, reproduites en fac-similé les trois œuvres découvertes il y a dix ans (les dix ans qu’il a fallu pour réaliser ce livre) : un bréviaire de colporteur intitulé Enchiridion du pape Léon (ενχειριδιον : petit traité d’exorcisme bien en main χειρ, qui ne vous quitte jamais, tout en recettes de magie blanche et noire), considérablement augmenté de deux addenda avant et après, saturé de dessins, motifs, alphabets, monogrammes et fragments d’écriture ; et deux albums de plus grand format sur vélin, porteurs de la même provende ; datant des années 1840, 50, 60 (« 1867 » inscrit sur l’album 2). Une vie s’écoule entre quelques villages de la vallée de la Canner, entre chemins creux et calvaires, à la frontière linguistique franco-allemande en Moselle ; sur la voie de passage des guerres napoléoniennes, par réquisitions impériales, exactions de Cosaques l’enfance gangrenée ; à l’ombre d’une veuve, l’éternelle enfance ; perdant sa mère à trente-trois ans, Pierre dépossédé de ses biens entre à l’hospice, qu’il quittera pour l’asile, un palais abbatial plus médical, à ses dernières années, où les pratiques psychiatriques de l’époque ont dû étouffer son art.
Grimoires, ou l’un des plus lancinants, fascinants livres d’artiste jamais créés – ici pour conjurer les démons, ange ou démon qu’importe (enfer ou ciel), s’y reproduire à plus soif, y coder son chemin de croix où les faibles d’esprit, répertoriés comme fous, ceux dont raffole un personnage de Sade, ont à leur main celle d’un siècle en Dieu, cet aval, cet ubac de délyre. D’un art brut d’aliéné, aliéné parce que Je est un autre. D’un art sans art, dont tout en redondances la véritable éloquence se moque de l’éloquence. Art lettriste de monogrammes dont le lettrisme fait figure de parent pauvre, Pierre Richard (sic) disposant de l’art pauvre entre tous, celui par lequel certains des derniers seront les premiers. – Les autres œuvres d’art brut connu, d’Adolf Wölfli (1864 – 1930), Carlo Zinelli (1916 – 1974), Aimable Jayet (1883 – 1953), Aloïse Corbaz (1886 – 1964), ne remontent pas d’aussi loin sur la portée des siècles.
Illuminations jaillies d’Une saison en enfer. En main la règle et le compas, dans le dénuement survolté de moyens. Ne sachant pas dessiner, tel un qui ne sai[t] plus parler. Les litanies, en français sans orthographe, incorporant patois francique et latin d’église. Paysan, dit Rimbaud.
Ivre de détresse non d’absinthe, forçat intraitable sur qui se referme toujours le bagne ; comme un ancêtre d’Ubu plante ses palotins, trinitaire en Un de face et de ses deux profils approfondissant le retour du même, petit bonhomme sème sa piste tombale de pentacles à six branches (un centre d’études talmudiques à Metz), talismans, sceaux, mandalas, lettrines, monogrammes, acronymes, planètes, chiffres en cryptogrammes, alphabets crochus. Plantée sur un triangle de stèle pointe en bas, nous hante sa tête récurrente de pierrot épaté, lunaire de soleil mort, chaussé d’étranges lunettes – un cercle tracé au compas, la bouche un trait, les yeux deux ovales couchés que relie un arc de cercle nasal, les pupilles deux points gras, le cou un trapèze aux flancs incurvés, variantes un rudimentaire noir bonnet d’âne à trois cornes de prédicateur, le triangle noir d’une langue tendue qui sinue en vipère fléchée, une rapière tenant lieu de sourire. Sans les moyens du Beau, en quête avec ceux du bord de mère morte.
« GLORIA. MARIA. / MARIQUA. UNIQUA. MARTIQUA/ SAINTE. L.ÈVANgielon. mysteria » rend hommage à l’Ève maternelle, celle dont les trois branches du E hérissent le monogramme du A de Richard. Autoportrait en Christ en pied, une pacifique plume à la main, coiffé de la calotte d’officiant bras écartés comme il se représente en croix : « reie eie. irie venie », ne rendant pas à César ce qui est dû à Christ-roi. Réplique inversée des deux larrons, à bras siamois petit bonhomme entre deux religieux en robe noire qui le dépassent d’une tête, ou deux anges ou deux saints, ou deux infirmiers psychiatriques, Saint-Esprit entre Père et Fils, bien et mal, moines ou diables : « tribon brison brison prison brison soins pensee » ; ou « Gurison. prison. prindi. primes / prions. prions. prions. perions. presons / preon. pènison. bènison. bènison. bènison ». En mélopée hypnotique, [litanique, psalmodique], inspirée par le culte chrétien où le desservant lance des paroles sur un ton assez haut et clair tandis que viennent en retour les répons graves et sourds des participants. [Trahissant une] pratique du codage quotidienne et assidue, [celle] de la kabbale [où il] répond à une dissimulation volontaire destinée à cacher une formule ou un mot interdits (Christophe Boulanger).
Récurrents : perché sur une pile de symboles, le coq girouette de clocher qui chanta quand Pierre eut trois fois renié le Christ ; la croix dans toutes ses versions, latine, grecque, croix trois fois potencée, se recroisant de crucifixions additionnelles, croix de Lorraine ; en filigrane l’échelle de Jacob figurant la montée au paradis, ou dédoublée en V jaillissant de la tête ; symétries et palindromes ; deux anges brandissant l’épée ; une tunique teintée de sang ; suspendue à un bec de colombe, la Trinité dans une nacelle bleutée plutôt qu’un sac poubelle peint en bleu ; un étrange véhicule spatial massif, de couleur verte et à ailerons raccourcis, propices au mouvement (François et Mireille Pétry). Le contraste est saisissant entre l’indigence du propos christique et la puissance évocatrice d’un précurseur.
En près de trois décennies accompli un travail sur soi d’intériorisation qui rend évident l’ordre des trois ouvrages, approximativement datés par François et Mireille Pétry. Révélation de la couleur avec l’album 1, le codage monte en complexité. L’album 2, de vélin plus fin, permet des effets de transparence renforçant, allégeant la mémoire, saturant davantage encore les pages comme par une montée des eaux ; petit bonhomme brandit bouclier et épée couverts à présent d’un plumetis, se métamorphose en fleur, tout son contour également fleuri, un apaisement à l’œuvre ; centrés sur une figure trinitaire apparaissent, colorés de rose ou de bleu pâle, de grands cercles composés d’une multitude de cercles concentriques où circulent planètes ; en lévitation un gris charnel ; les dernières images celles de petit chose en Jésus triomphant sur la croix entre deux « témoins », dans une confusion de lettres et de symboles, le supplice rédimé en apothéose.